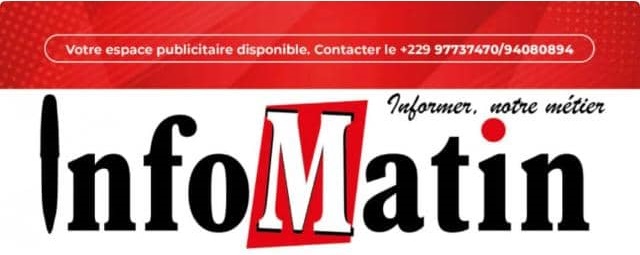Gestion économique et politique du Bénin : Patrice Talon ou la dictature de l’efficacité

Le président Patrice Talon a reçu un aréopage de jeunes venus de divers horizons socio-professionnels et de plusieurs sensibilités politiques. L’audience a permis aux invités et à leur hôte d’échanger autour de plusieurs sujets d’intérêt général,notamment la gouvernance, le développement, l’engagement citoyen, l’éducation, les questions prospectives. Ce fut surtout l’occasion pour le chef de l’État d’exposer sa vision et ses projections pour l’avenir. Un développement sur lequel Docteur Saïdou Sabi Boun nous propose une tribune libre que nous partageons avec nos lecteurs.
Le Bénin de Patrice Talon ou la dictature de l’efficacité
Le 28 juillet dernier, dans un exercice de pédagogie politique à dix mois de la fin de son second et ultime mandat constitutionnel, le chef de l’État du Bénin, Patrice Talon (PT), a reçu une centaine de jeunes Béninois à la Maison de la présidence pour expliquer sa vision économique et pour discuter de l’avenir du pays. Le chef de l’État, devant un auditoire attentif, a répondu aux questions des jeunes qui étaient rassemblés, comme s’il participait à une conférence de presse. Au nombre des sujets abordés au cours, en tant que professionnel du développement international, un principal retient mon attention : celui de la gouvernance économique et politique du Bénin.En répondant à une question sur la loi encadrant le travail au Bénin et favorisant l’investissement « en apparence » au détriment du travailleur salarié, le président a expliqué sa vision. Il s’agirait, selon lui, d’un cadre juridique maintenu par inertie qui surprotège les employés et qui constitue un frein structurel à la compétitivité et aux investissements au Bénin. La modification de cette loi favoriserait les employeurs et les capitaux qui, par ricochet, bénéficieraient aussi aux salariés. En réalité, cette idéologie connue sous le nom de « théorie du ruissellement » a longtemps été utilisée en développement international, pour expliciter des politiques favorables aux investissements et capitaux et qui, par écoulement, avantageraient le bien-être des travailleurs. À cela, PT ajoute que le marché déréglementé pourrait agir comme « une main invisible » pour réguler le marché du travail, en créant la concurrence entre les employeurs. La « main invisible », est une théorie formulée par l’économiste écossais Adam Smith en 1776, qui postule que les actions individuelles guidées par l’intérêt personnel contribuent involontairement au bien-être collectif. En conséquence, dans un marché libre sans entraves d’un État, la concurrence se comporterait comme une « main invisible » pour coordonner l’offre et la demande, permettant d’optimiser l’allocation des ressources tout en stimulant l’innovation sans nécessiter d’intervention étatique centralisée. Le mécanisme énoncé par cette théorie est que les investisseurs, en cherchant à maximiser leurs profits, répondent à la demande des consommateurs, qui à leur tour vont se tourner vers les meilleurs produits au prix le plus bas. Cela a pour conséquence de produire la concurrence libre qui pousserait à l’efficacité et à la baisse des prix, avec pour résultat une croissance économique auto-équilibrée. Cette théorie, qui sous-tend les politiques libérales des années 1980-1990, a donné lieu aux célèbres programmes d’ajustement structurel (PAS) dirigés par la Banque mondiale et le FMI (privatisations, dévaluation du franc CFA), avec des résultats très mitigés. Mais à y regarder de près, la politique de Cotonou est-elle vraiment une politique libérale ? Au regard des décisions politiques et économiques prises par Cotonou, quelle est concrètement l’idéologie du régime de PT ?
L’État développeur : le modèle asiatique adapté au Bénin
Contrairement à la théorie libérale qui prône un retrait de l’État de l’activité économique, la trajectoire suivie par le Bénin, ressemble davantage à ce qu’on appelle la théorie de « l’État développeur ». Cette théorie a été introduite pour la première fois par Chalmers Johnson pour décrire le redressement économique du Japon après la Seconde Guerre mondiale, et a également été utilisée pour décrire le développement de ce qu’on appellera plus tard les tigres asiatiques, comme Singapour, Taïwan et la Corée du Sud et de nombreux autres pays, comme la Malaisie, le Botswana et, dans une certaine mesure, le Rwanda. La théorie de l’État développeur repose sur plusieurs piliers fondamentaux. Nous en étudierons les 4 principaux pour montrer la similarité de la trajectoire des États développeurs et de celle du Bénin sous l’ère de PT :
1. Une centralisation d’un pouvoir étatique ;
2. Une méritocratie administrative ;
3. Une faible société civile ;
4. Une économie dirigée par une élite patriotique compétente.
Centralisation du pouvoir et élites développementalistes : le Bénin sur les traces des Tigres asiatiques ?
Au Bénin, comme naguère dans les tigres asiatiques, l’État se construit autour d’un pouvoir fortement centralisé. Sous les deux mandats de PT, les prérogatives des autorités politiques et administratives locales (maires, préfets, conseilleurs municipaux, chefs de quartier/village, etc.) conférées par le système décentralisé mené les deux dernières décennies se sont progressivement rétrécies au profit du pouvoir central. La crise entre l’ancien gouvernement et l’ancien maire de Cotonou — aujourd’hui en exil politique — en est un exemple palpable. Sous PT, la création de nouveaux marchés et l’opérationnalisation de l’Agence nationale de gestion des marchés (ANAGEM) ont sonné le glas de la Société de Gestion des Marchés Autonome (SOGEMA), symbole des tensions passées entre le pouvoir exécutif des anciens régimes et la municipalité de Cotonou, parce que le second voulant s’approprier de la gestion des marchés de Cotonou au détriment du premier. Une page semble donc tournée, après dix ans d’un pouvoir résolu à unifier la gouvernance économique. Cette centralisation du pouvoir, à l’image des modèles sud-coréens, singapouriens ou malaisiens, a pour conséquence un pilotage du Bénin par une élite développementaliste restreinte composée de hauts fonctionnaires et politiciens bien rémunérés, proches du chef de l’État, qui façonne la culture politique et économique du pays. À l’image des États développeurs asiatiques et africains qui ont réussi — comme Singapour sous Lee Kuan Yew (1959-1990), la Corée du Sud dirigée d’une main de fer par Park Chung Hee (1961-1979) après son coup d’État, ou le Botswana des présidents Seretse Khama et Ketumile Masire (1965-1998), le Bénin semble reproduire ce schéma éprouvé des cercles décisionnels restreints autour d’un leadership fort, où technocrates et politiques œuvrent en synergie autour d’une vision développementaliste claire et unifiée.En outre, dans beaucoup de trajectoires d’État développeur, il existe une porosité entre la bureaucratie, l’armée et le pouvoir politique, ayant souvent servi de levier au développement. Le Bénin, sans militarisation marquée, voit cependant se consolider une administration étroitement liée au régime. Un phénomène qui n’est pas sans évoquer la Corée du Sud de Park Chung Hee, où les postes clés étaient tenus par des militaires unis autour d’une vision développementaliste à pas forcés, au Botswana des années 1980, où près de la moitié des ministres étaient d’anciens hauts fonctionnaires et en Indonésie, dirigée par Haji Mohamed Suharto (1967-1998), où l’armée et l’administration comptaient pour un tiers des cabinets. Si Cotonou n’en est pas encore à ce niveau d’imbrication entre l’armée et le pouvoir politique, la prise du pouvoir par les conseils politiques et les technocrates autour du pouvoir politique ressemble davantage à une direction d’État développeur, où la stabilité rime avec la verticalité du pouvoir.La méritocratie administrative, levier des États développeurs : le Bénin à l’école des Tigres asiatiques ?Sous les deux mandats de PT, le Bénin a engagé une refonte de son administration, alignant recrutement et gestion des fonctionnaires sur des critères de compétence. Les scandales de concours nationaux naguère truqués sont de plus en plus rares — une tendance confirmée par l’indice Mo Ibrahim, qui classe désormais le pays 13ᵉ sur 54 en matière de bonne gouvernance (58,9/100, soit +3,4 pts depuis 2014). De même, selon le même indice, la perception des Béninois sur la lutte contre la corruption a bondi de 43,2 % en dix ans. Cette dynamique rappelle celle des États développeurs, où la méritocratie fut un pilier du décollage économique. À Singapour, sous Lee Kuan Yew (1959-1990), l’efficacité administrative a été érigée en dogme, ce qui a permis d’attirer de nombreux talents internationaux et de contribuer à réduire la corruption. La Corée du Sud de Park Chung Hee (1961-1979) avait quant à elle militarisé l’administration pour en faire un outil de croissance, avec de hauts fonctionnaires triés sur le volet, alors que le Botswana, modèle africain d’État développeur, a maintenu une bureaucratie compétente malgré un système de parti dominant, ce qui a permis d’éviter les dérives clientélistes. Le signe tangible de cette transformation est que le Bénin voit aujourd’hui sa diaspora et des cadres expatriés, quitter l’Europe, le Canada ou les États-Unis pour rejoindre ses institutions. Parmi ces cadres, on peut citer les plus médiatiques : Angela Aquereburu Rabatel, réalisatrice franco-togolaise nommée à la tête de la Société des Radios et Télévision du Bénin (SRTB), Karine Istin, ancienne responsable des hôpitaux parisiens, qui dirige désormais le Centre Hospitalier International de Calavi et Pascal Nyamulinda, ancien maire de Kigali ayant piloté l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) — preuve que l’expertise rwandaise post-génocide a inspiré Cotonou. Ces recrutements internationaux, parfois critiqués comme étant des « bypass » des talents locaux, illustrent une stratégie assumée. Comme en Malaisie sous Mahathir Mohamad (1981-2003) ou au Rwanda post-1994, le Bénin parie sur des compétences éprouvées, quitte à importer des savoir-faire. Il s’agit là d’un calcul risqué, mais qui, jadis, a permis à d’autres pays de décoller et de se mettre sur les rails du développement. Il reste à éviter au Bénin le verrouillage politique masqué par la méritocratie administrative qui a constitué l’écueil des États développeurs. Pour que le Bénin concilie développement et pluralisme, son administration ne devrait pas servir à renforcer un pouvoir trop centralisé. En ce sens, les élections présidentielles de mars 2026 seront capitales pour trouver un équilibre entre un cap développementaliste et un pluralisme qui fera vivre la démocratie béninoise. Société civile sous contrôle : le Bénin, un État développementaliste en gestation ?Depuis l’arrivée au pouvoir de PT, la société civile béninoise — syndicats, organisations non gouvernementales, médias — voit son espace se rétrécir, suivant une trajectoire familière aux États développeurs. Ce qui ramène à cette essentielle en développement international : la répression des contre-pouvoirs est-elle le prix à payer pour un « décollage économique » ?Comme en Corée du Sud sous Park Chung Hee (1961-1979) ou à Singapour sous Lee Kuan Yew, (1959-1990), le Bénin a renforcé son pouvoir exécutif au détriment des contre-pouvoirs et des voix dissidentes. Les grèves ont été limitées dans les secteurs stratégiques (ports, aéroports, énergie), rappelant les mesures autoritaires malaisiennes des années 1970. D’ailleurs, le classement de Reporters sans Frontières (RSF) place le Bénin à la 92ᵉ place mondiale pour la liberté de la presse (score : 54,6), en chute de 20 points depuis 2016, et douze journalistes ont été détenus entre 2016 et 2025. Cette tendance évoque également la Thaïlande des années 1980, où la critique du régime était criminalisée. La restriction du droit de grève dans les services publics (santé, justice, transport) s’inspire des pratiques indonésiennes post-1966, où Haji Mohamed Suharto avait brisé les mouvements ouvriers pour stabiliser son régime et mettre son pays sur la voie du développement. Ces restrictions de libertés individuelles s’accompagnent paradoxalement d’une légitimité persistante, comme ce fut le cas en Chine ou au Botswana. Les réformes attirent des investisseurs et la diaspora, justifiant, aux yeux d’une partie de la population, la priorité donnée à la « stabilité ». Contrairement aux pays de l’Amérique latine, où des sociétés civiles vigoureuses ont bloqué les réformes, le Bénin de PT— comme jadis les tigres asiatiques — a misé sur un État fort pour éviter les blocages.Le Bénin se trouve donc à une croisée des chemins, car l’histoire montre que les États développeurs finissent tôt ou tard par affronter leurs contradictions. En effet, sans contre-pouvoirs véritables, la corruption pourrait ressurgir (comme en Indonésie post-Suharto), ou alors, comme au Botswana, le Bénin pourrait concilier croissance et pluralisme relatif. Une économie dirigée par une élite patriotique et compétente. Le Bénin de PT a parié sur une modernisation technocratique inspirée des États développeurs, combinant efficacité bureaucratique et un contrôle stratégique de l’économie. Une approche qui rappelle les agences pilotes de la Corée du Sud ou de Singapour. Comme l’« Économic Planning Board » Sud-Coréen dans les années 1960, le Bénin numérise ses services fiscaux pour éliminer les fraudes. Résultat ? Une hausse des recettes fiscales et une administration moins poreuse aux détournements — à l’image de Singapour, où Lee Kuan Yew avait éradiqué la corruption en militarisant la transparence. Le Glo-Djigbé Industrial Zone (GDIZ) se veut être l’équivalent béninois des zones économiques spéciales qui ont propulsé la Chine ou la Malaisie. L’ambition affichée par les autorités béninoises est de créer une chaîne de valeur comme Shenzhen en Chine dans les années 1980, en misant sur la transformation locale (coton, anacarde) pour éviter la malédiction des matières premières brutes décrite pour plusieurs États. Si le Bénin commence à reproduire certains succès des États développeurs (Corée, +7 % de croissance/an sous Park et +7,16 % en 2022 sous PT), il doit en éviter les dérives, notamment le risque d’opacité et l’absence de débats et de dialogue politique. L’histoire montre que la centralisation excessive comporte des risques. En Indonésie, la compagnie pétrolière Pertamina est devenue un État dans l’État, alimentant la corruption et le clientélisme. À l’inverse, le Botswana a su bâtir sa politique industrielle autour de ses ressources traditionnelles (bétail et diamants) en créant des entreprises publiques ciblées, comme la Botswana Meat Commission et la Botswana Development Corporation. Ce modèle a permis à la fois de développer les infrastructures et de mieux redistribuer les richesses. Le défi pour le Bénin sera d’éviter les dérives du premier modèle tout en stimulant l’innovation, menacée par une centralisation trop poussée.Le Bénin de PT a emprunté résolument la voie des États développeurs, combinant centralisation du pouvoir, méritocratie administrative et modernisation économique accélérée. Comme jadis Singapour, la Corée du Sud ou le Botswana, Cotonou parie sur un État fort pour impulser sa transformation, quitte à marginaliser temporairement certains contre-pouvoirs et des voix dissidentes. Pourtant, ce modèle n’est pas sans risques. L’histoire montre que les « miracles économiques » asiatiques ont souvent alterné succès retentissant et crises politiques liées à leur verticalité excessive. Le défi béninois consistera donc à éviter le piège autoritaire en maintenant un équilibre entre efficacité technocratique et respect des libertés publiques — à l’image du Botswana, rare exemple africain ayant concilié croissance et pluralisme. En s’inspirant de certains modèles aujourd’hui remis en cause (la Chine en raison de diverses tensions sociales, Singapour en raison de son contrôle excessif sur la population), le Bénin pourrait peut-être inventer une troisième voie — un développementalisme africain, à la fois ferme sur ses objectifs et soucieux de son contrat social. La réponse se jouera dans la capacité des politiques à écouter, demain, ceux qu’elles silencent partiellement aujourd’hui.
Saidou Sabi Boun
PharmD, MSc, MPH, PhD Candidate International Development Université d’Ottawa.